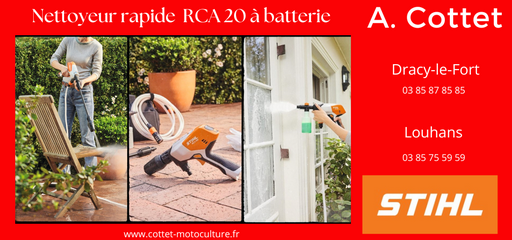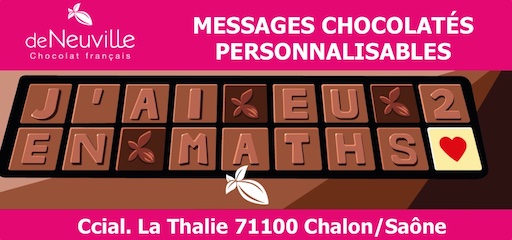Chalon sur Saône
Pour cette première édition des Rencontres de l'Initiative à Chalon, il s'agissait de rebâtir des collectifs forts et locaux
Publié le 03 Juillet 2014 à 17h23

Mardi à Chalon-sur-Saône, les trois chambres consulaires de Saône-et-Loire lançaient les premières Rencontres de l’initiative visant à soutenir et développer l’activité économique du département. En clair, créer ou recréer des liens de proximité entre chefs d’entreprises - qu’ils soient commerçants, artisans, agriculteurs, dans l’industrie ou dans les associations - en lien avec les organisations professionnelles et les services publiques.
Avec une configuration style "plateau télé", les interventions étaient filmées et retransmises en direct par Internet, avec même un "live tweet" pour réagir et partager sur Twitter (#rdi71), réseau social très prisé des journalistes.
Au-delà de la forme, sur le fond, ces premières Rencontres de l’initiative se voulaient une « démarche innovante ». D’ailleurs, peu de territoires en France peuvent se vanter d’avoir une « collaboration aussi forte », notaient les animateurs extérieurs, entre les trois chambres consulaires du département. L’origine de se rapprochement remonte à 2007-2008, à l’aube de la crise financière qui s’est propagée par la suite à l’économie réelle puis aux dettes des Etats, qui étaient déjà endettées, alors que le préfet de l'époque, Michel Lalande, réunissait les acteurs de l'économie départementale pour des comités de suivi régulier...
Partager les solutions, plutôt que les problèmes
Du coup, en matière de problématiques économiques et d’emplois, « il n’y a pas tant de différences que cela entre un patron, un agriculteur, un artisan, un commerçant… », notait Christian Decerle, président de la chambre d’agriculture. Son homologue du commerce et de l’industrie, Bernard Echalier, expliquait ainsi la nécessité « d’animer le débat économique, qui se fait habituellement dans de grandes métropoles » avec de grandes manifestations. En effet, pour le président de la chambre des métiers de l’artisanat, Marcel Chifflot, sinon les liens « dépérissent et il devient trop facile d’aller chercher loin les produits ou les services qu’on a à côté de soi ». Après ces explications, une large place était laissée aux témoignages d’entrepreneurs.
Première étape : gommer ses handicaps
Première à s’élancer, Salima Bénichou, chargée de la marque territoriale Creative LABourgogne, souhaite « gommer ses handicaps, communiquer son énergie aux porteurs de projets et faire la somme des atouts et des talents de la Saône-et-Loire ».
Evidemment, parmi les ambassadeurs contribuant à la visibilité et notoriété du département, la viticulture est un fleuron. Viticulteur et chef d'entreprise, Emmanuel Nonain « met en tourisme le territoire » au travers du mot magique "chardonnay", par exemple, lequel met en relation vin, cépage, territoire et le village. Les touristes le découvrent. Luthier à Donzy-le-pertuis, Pascal Grandca indiquait que 300 entreprises d’art « à la recherche souvent de simples fermes parfois », travaillent « majoritairement » aussi en milieu rural, attirant ensuite des clients français et étrangers.
Quant à Jean-Yves Labrosse, PDG de Net4G qui propose aux acteurs du tourisme de gérer leurs clients de façon numérique, il symbolise une économie qui se numérise. « On bascule du tourisme et loisirs à l’ensemble du commerce ». Il faut dire que le client final recherche désormais sur internet, avant, pendant son voyage, voire même après en partageant ses aventures, bonnes comme mauvaises d'ailleurs.
Le local en retard numérique
Un phénomène qui n’a pas échappé à Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui constate que seul « un pro sur deux fait partie du monde digital ». L’assureur vert lance donc son "Granvillage" qui permettra à tous de pouvoir communiquer de façon simple sur le Web. Mais si l’on comprend bien l’intérêt pour un producteur, un artisan, un commerçant ayant de multiples clients à contacter, qu’en est-il pour un industriel ? De la chaudronnerie Jousseau à Viré, Dominique Jousseau travaille avec de « gros donneurs d’ordre mondiaux ». Dès lors, si évidemment les « grands axes » de transport sont nécessaires, « au niveau local, avec le commerce de proximité, la difficulté est d’avoir un minimum vital ».
Former vos bataillons !
Au Creusot, le cluster de 82 entreprises Mécateamcluster a lui carrément séduit les grands donneurs d’ordre (Bouygues, Vinci…) qui se sont impliqués et installés. Une opportunité pour développer des formations avec l’Université de Bourgogne sur le ferroviaire, unique en France. Autre "grappe" avec GA2B, cette fois spécialisée en domotique : une quarantaine d’entreprises font des projets collaboratifs jusqu’à la « recherche d’innovations », se félicitait Patrick Tabouret, le PDG d’Arcom. La concurrence locale passant au second plan finalement.
Circuit local court et long
C’est également la philosophie qui prévaut à la fédération des Unions commerciales de Saône-et-Loire qui a mis en place auprès de 600 magasins, les chèques-vitrines. « 95 % sont ensuite dépensés dans la ville même d’émission », indiquait Jocelyne Charolles, sa présidente, qui veut mettre en avant le commerce de proximité traditionnel et lutter contre les chèques cadeaux des grandes enseignes. La minoterie Gay à Baudrières a réussi à multiplier par trois son chiffre d’affaires avec sa filière courte "Le dorée", « tracée de la semence jusqu’au pain », rassurant ainsi un client devenu méfiant depuis les scandales sanitaires. Un "Made in Bourgogne" que l’on retrouve également chez i-Tech Bois à Cluny, jeune entreprise innovante qui propose l'isolation des bâtiments par l'extérieur.
Réinjecter l'épargne dans l'activité locale
Le cabinet de conseil KPMG souligne accompagner toutes ces formes sociétaires, des PME familiales aux multinationales, en passant par les associations solidaires. Sylvie Merle, associée, pointait néanmoins un point commun à toutes : la recherche de financement difficile.
Emmanuel Vey, directeur adjoint du Crédit agricole Centre-Est, n’évitait pas la question. Il re-contextualisait toutefois, rappelant que l'économie est toujours en crise. Certains secteurs d'activité ayant d’ailleurs des taux de défaillances « effarants » encore aujourd’hui. Là aussi, il insistait sur l’importance du collectif pour tout projet. « Dès lors qu’un projet est porté par une collectivité locale, le taux de défaillance tombe à 10-15 % ». La réussite historique du modèle agricole a fait ses preuves et résiste encore. La banque verte continue donc de « réinjecter localement » l’épargne dans l’activité, notamment à travers un livret dédié et souscrits déjà par 75.000 clients en Saône-et-Loire.
Avec autant de volonté - tant du côté des producteurs, que des transformateurs, que des commerçants, que des consommateurs - l’économie de proximité peut rebondir et s’inventer un avenir. Les élus en sont convaincus. A condition de jouer collectif et de faire l’effort de s’ouvrir aux autres, en regardant à côté de soi…
Qu’est-ce que l’économie de proximité ?
La définition de l’économie de proximité regroupe l’ensemble des secteurs d’activités privés dont l’activité est consacrée à la production de biens et de services consommés localement. Elle a pour principe d’être difficilement délocalisable et permet également d’insérer des actifs "exclus" de la sphère productive concurrentielle. Un cercle vertueux donc. L’économie de proximité se caractérise par sa partie productive locale qui n’est pas mondialisé (secteur abrité). Elle représente en moyenne deux tiers de l’emploi des territoires. Elle possède un spectre de qualifications requises plus ouvert au "basses" (dans l’échelle sociale) qualifications que dans le secteur productif basique. Enfin, son bassin d’emploi est moins étendu et permet une meilleure injection des revenus qu’il génère dans l’économie locale.
Cédric Michelin



-
 Avis de recherche après la disparition de Philippe Monin
Avis de recherche après la disparition de Philippe Monin -
 Beaune - 1 084 convives enchantés par un dîner gastronomique exceptionnel pour la Saint-Vincent Tournante 2025
Beaune - 1 084 convives enchantés par un dîner gastronomique exceptionnel pour la Saint-Vincent Tournante 2025 -
 Après Saint-Germain-du-Bois puis Allériot, c'est désormais à Chalon sur Saône que l'Atelier des 3 mondes poursuit son développement
Après Saint-Germain-du-Bois puis Allériot, c'est désormais à Chalon sur Saône que l'Atelier des 3 mondes poursuit son développement -
 ANNULATION de la venue d’ALEXANDRE ASTIER prévue ce samedi 1er février au Festival de cinéma Chefs op en Lumière
ANNULATION de la venue d’ALEXANDRE ASTIER prévue ce samedi 1er février au Festival de cinéma Chefs op en Lumière -
 Cette année, c’est un carnaval 2025 Chalonnais à « l’échelle mondiale » qui vous sera proposé, sur le thème des Fables de la Fontaine’ ; Découvrez le programme !
Cette année, c’est un carnaval 2025 Chalonnais à « l’échelle mondiale » qui vous sera proposé, sur le thème des Fables de la Fontaine’ ; Découvrez le programme ! -
 D'ici l'été, vous pourrez relier directement la zone Californie à l'Espace Nautique du Grand Chalon en totale sécurité
D'ici l'été, vous pourrez relier directement la zone Californie à l'Espace Nautique du Grand Chalon en totale sécurité -
 Il n’avait pas mis sa ceinture de sécurité, ce 1er décembre, alors qu’il roulait dans Chalon. 136 pots de tabac, plus de 3 kg de cannabis et 13 000 euros en espèces à la clé
Il n’avait pas mis sa ceinture de sécurité, ce 1er décembre, alors qu’il roulait dans Chalon. 136 pots de tabac, plus de 3 kg de cannabis et 13 000 euros en espèces à la clé -
 Plus de confort et plus de convivialité au restaurant Boeuf et Grill entièrement rénové en zone Sud de Chalon
Plus de confort et plus de convivialité au restaurant Boeuf et Grill entièrement rénové en zone Sud de Chalon -
.jpg) TRIBUNAL DE CHALON - Un garage en carafe et un squat en bonne forme à Crissey
TRIBUNAL DE CHALON - Un garage en carafe et un squat en bonne forme à Crissey -
 ZFE à Dijon : "stop aux folies escrologistes qui pénalisent les Français !" dénoncent les élus régionaux du Rassemblement National
ZFE à Dijon : "stop aux folies escrologistes qui pénalisent les Français !" dénoncent les élus régionaux du Rassemblement National -
 Y'a du rapprochement dans l'air à Chalon ...
Y'a du rapprochement dans l'air à Chalon ... -
 4e Label Or pour la section de ‘marche nordique’ du Grand Chalon Athlétisme
4e Label Or pour la section de ‘marche nordique’ du Grand Chalon Athlétisme -
 Vœux du maire aux Chalonnais : Des pistes pour l'avenir
Vœux du maire aux Chalonnais : Des pistes pour l'avenir -
 Vigilance jaune aux vents violents en Saône et Loire activée à partir de 18H
Vigilance jaune aux vents violents en Saône et Loire activée à partir de 18H -
 Une maison de santé pluri-professionnelle multi-sites : ouverture en septembre 2025 a annoncé Nelly Meunier-Chanut lors des vœux aux habitants.
Une maison de santé pluri-professionnelle multi-sites : ouverture en septembre 2025 a annoncé Nelly Meunier-Chanut lors des vœux aux habitants. -
 Retour en images sur le repas-choucroute de l'Union des comités de quartiers de Chalon-sur-Saône
Retour en images sur le repas-choucroute de l'Union des comités de quartiers de Chalon-sur-Saône -
.jpg) TRIBUNAL DE CHALON - En cavale, il commet plusieurs vols en Bresse
TRIBUNAL DE CHALON - En cavale, il commet plusieurs vols en Bresse -
 À Chalon-sur-Saône, la municipalité lance une bourse au bénévolat
À Chalon-sur-Saône, la municipalité lance une bourse au bénévolat -
 Enfin du soleil en Saône et Loire ?
Enfin du soleil en Saône et Loire ? -
 MUNICIPALES - Le mystère entretenu par Dominique Juillot à Mercurey
MUNICIPALES - Le mystère entretenu par Dominique Juillot à Mercurey -
 L'épicerie Proximarché, nouvelle locomotive pour le commerce aux Aubépins
L'épicerie Proximarché, nouvelle locomotive pour le commerce aux Aubépins -
 Maxime Bouchard, nouveau conseiller funéraire des Pompes funèbres BRIGITTE ROLLAND
Maxime Bouchard, nouveau conseiller funéraire des Pompes funèbres BRIGITTE ROLLAND