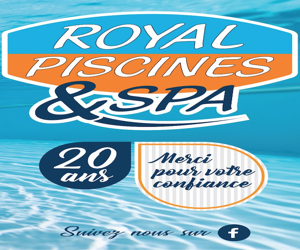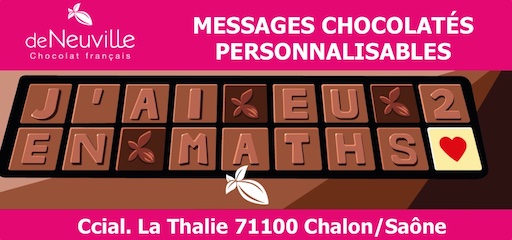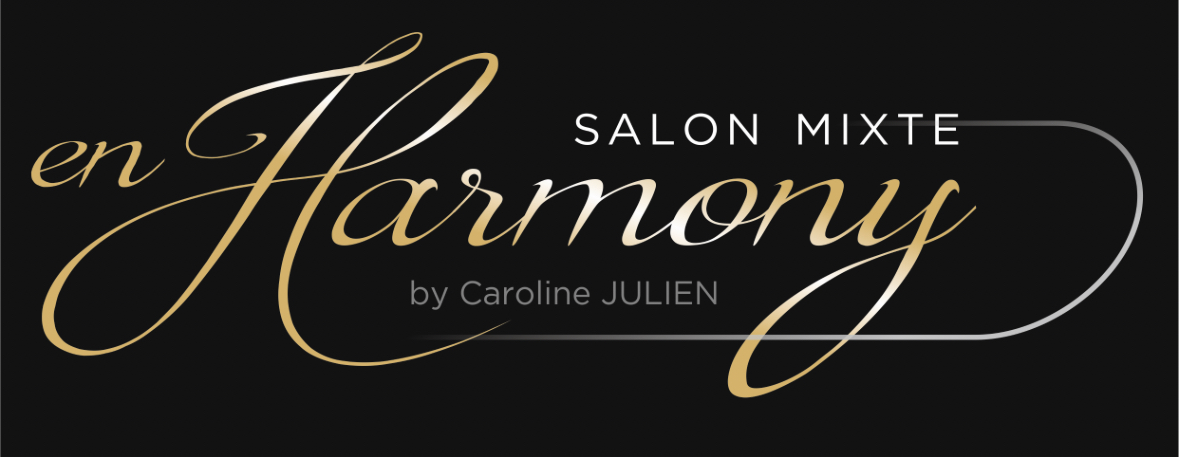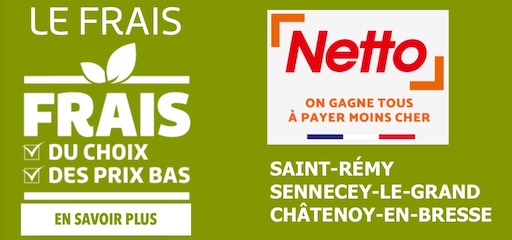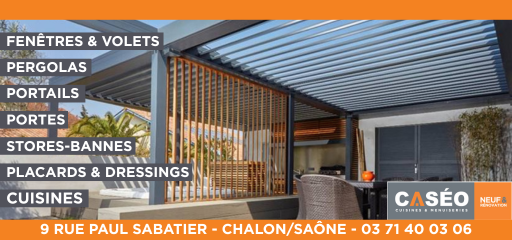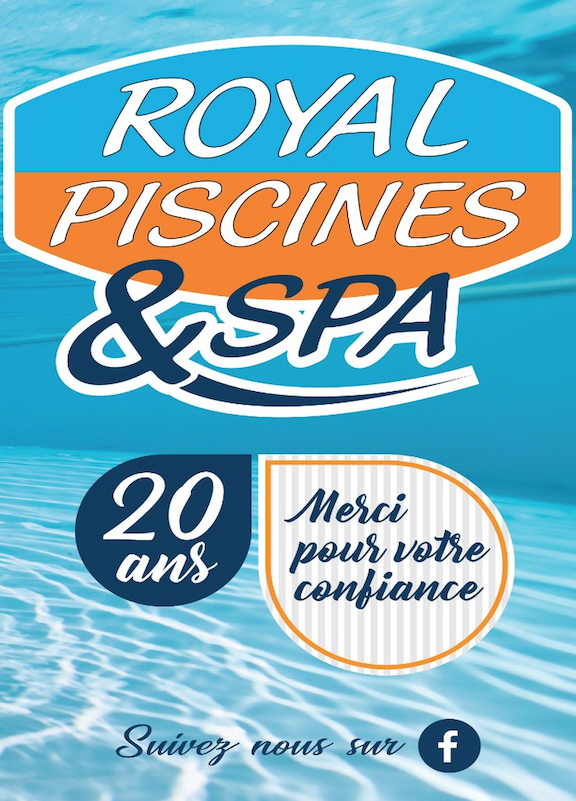Bourgogne
La viticulture de demain c’est maintenant en Bourgogne
Publié le 05 Novembre 2014 à 07h45

Robots, drones, pilotage à distance, automatisation, numérisation des itinéraires techniques, visualisation et cartographie en réseau dans le cloud, capteurs et big data, etc… Les vignerons vont devoir appréhender de nouveaux outils… ou pas.
Beaucoup promettent une "révolution" du métier de vigneron et au-delà même. Mais qu’en est-il vraiment ? Les Grands rendez-vous techniques de Bourgogne organisés par l’Interprofession (BIVB) ont voulu faire le point et ont mis le cap sur « L’innovation : clé de la viticulture de demain ».
Les 4 et 5 novembre à Beaune, la viticulture bourguignonne revêtait son habit moderne. La tradition n’étant qu’une innovation qui s’est imposée, pour reprendre une citation de la précédente édition. Et ça commençait fort avec Gilbert Grenier, de Bordeaux Sciences Agro Laboratoire IMS. Pour ce chercheur, imagerie, drones, automates sont des outils innovants au service de la performance qui vont induire un « changement de paradigme ». En quoi le modèle viticole sera-t-il révolutionné ? « Sur les mesures, sur les analyses, sur les décisions, sur les actions ou modulations et sur les retours d’expérience », synthétisait-il. Il développait chaque point : mesures à l’aide de capteurs, tous géolocalisés pour enrichir des cartes numérisées permettant des analyses croisées avec d’autres données (météo…) pour arriver à trouver des explications à des problèmes concrets (vigueur différente dans une parcelle, plantation de pieds automatique…). Pour « passer de la mécanisation à l’automatisation », les capteurs et l’informatique vont envahir les exploitations, allant des Smartphones (applications) aux toits et cabines des enjambeurs (Isobus, RTK…). Aucune de ces technologies n’est vraiment nouvelle mais la convergence de toutes fait sauter les « verrous technologiques » d’antan.
Pour le BIVB et Vitagora, Franck Brossaud et Claire Van Overstraeten parlaient des projets lancés en Bourgogne, Damav et Iris. Damav - pour la Détection automatique des maladies de la vigne - est « né avec la flavescence dorée ». L’objectif étant de développer une solution pour détecter rapidement et largement les pieds touchés par la maladie. Prospection actuellement réalisé et possible grâce à une large mobilisation des vignerons. La « captation d’images » par drones n’est pas aisée cependant. Car ici, les rangs de vigne sont incurvés et en pente, nécessitant un « pilotage automatisé » complexe. Le projet Damav associe pour cela, rien de moins que l’entreprise Airbus. Mais ce n’est pas le seul défi. « Un symptôme sur feuille n’est jamais identique ». Hors, l’informatique reste binaire (0 ou 1). Il faut donc développer un « système capable d’apprendre par l’expérience ».
C’est un peu ce que cherche à faire aussi le Vinipôle Sud Bourgogne et Le2i, laboratoire spécialisé dans l’imagerie et basé au Creusot. Là, c’est la « demande sociétale » pour réduire les doses phytosanitaires (plan Ecophyto) qui est à l’origine, rappelait Didier Sauvage. L’idée est d’avoir des outils pour caractériser en temps réel le feuillage et ensuite arriver à moduler les doses de produits. Si Ralph Seulin est confiant dans sa mesure optique 3D - « sans contact » à la manière « des ultrasons d’une chauve souris » imageait-il justement -, le traitement des données ensuite est « encore loin de proposer un concept de modulation pour la pulvé » en fonction de la présence ou absence ou encore de la densité du feuillage. « On y travaille et on en est à la moitié de la deuxième étape pour aller vers la décision et adapter sur les systèmes embarqués » positivait Didier Sauvage. D’ailleurs, de Tecnoma, Jérôme Mestrude rajoutait que « les pulvé sont déjà plus ou moins prêt à recevoir des consignes d’application », en raison des progrès informatique pour traiter les données à partir des capteurs.
Tous ces projets intéressent particulièrement Jean-Paul Douzals, qui travaille à l’IRSTEA sur les matériels de pulvérisation. Toujours dans le but de limiter la dérive et les impacts environnementaux, pour assurer la protection des plantes à différents stades de végétation, il s’attache donc à créer un "compteur". « C’est comme en voiture. On vous dit de limiter vos vitesses, mais là, pour la pulvé, vous n’avez pas de compteur ! », pointait-il du doigt. La viticulture étant le « parent pauvre » par rapport aux autres cultures en la matière.
Un outil simple que ne reniera pas Christophe Gaviglio, de l’IFV, qui s’attache justement à tester les nouveautés matériels - des constructeurs la plupart du temps - pour le travail de la vigne et du sol. « Productivité, sécurité, confort et exigence de travail », sont les qualités qu’il recherche dans toute innovation matérielle. Il listait une série de matériels "innovants". « L’éco-conception apporte aussi son lot de nouveauté. D’ailleurs, un palier sera franchi dans tous ces domaines avec la robotique », concluait-il.
Décidemment, les vignerons sont poussés à devenir des geeks, non pas dans le sens de fan(atiques) de nouveautés mais bien dans celui de ce qu’ils sont déjà, des personnes extrêmement pointus dans le domaine qui est le leur : la viticulture.
Climatologie et pédologie de précision
Et la terre, l’eau, le vent… dans tout cela ? Les vignerons de Bourgogne veulent garder les pieds sur terre et dans leurs vignes. Et ce n’est pas Pierre Curmi d’AgroSup Dijon ou Benjamin Bois de l’IUVV qui les en détourneront. Si les cartes pédologiques actuelles sont à échelle 1/100.000e, (un cm sur carte = 1 km sur le terrain), Pierre Curmi veut se rapprocher de la « connaissance quantitative et du comportement des sols » que seuls connaissent les vignerons. En se rapprochant ainsi des secrets des terroirs bourguignons, il espère « aussi prévoir des choses qu’on n’a jamais connu ». Il cherche donc à collecter un maximum de données (résistivité des sols, humidité des sols…) pour créer des modèles. Et il n’hésite pas à utiliser des drones « pour extrapoler sur de plus grandes surfaces » ensuite, toujours avec un souci de précision avec des cartographies à haute précision. Derrière se cache en effet des renseignements utiles comme une estimation de la réserve utile en eau des sols, information qui pourra permettre une prévision du régime hydrique à l’échelle du cep par exemple. De quoi gérer au plus fin l’enherbement, enchainait Benjamin Bois. Venant en complément du sol, il étudie le climat notamment. Si de nombreux projets vont aboutir à des outils d’aide à la décision chez les viticulteurs, Benjamin Bois attirait toutefois l’attention sur leur accompagnement. « Il faut faire des efforts pour s’approprier ces outils cartographiques » et les vignerons auront besoin de « se former et de s’informer » sur ces nombreuses solutions commerciales.



-
 Attention fermeture annoncée du Pont de Bourgogne la semaine prochaine
Attention fermeture annoncée du Pont de Bourgogne la semaine prochaine -
 300 véhicules contrôlés ce lundi par les gendarmes de la compagnie de Chalon sur Saône... et une multitude de contraventions
300 véhicules contrôlés ce lundi par les gendarmes de la compagnie de Chalon sur Saône... et une multitude de contraventions -
 Accident en cours sur la RCEA entre Montchanin et Chalon
Accident en cours sur la RCEA entre Montchanin et Chalon -
 Inauguration du nouveau supermarché Colruyt de Châtenoy le Royal.
Inauguration du nouveau supermarché Colruyt de Châtenoy le Royal. -
 La saison des orages est ouverte en Saône et Loire
La saison des orages est ouverte en Saône et Loire -
 CONSEIL MUNICIPAL CHALON - Donation de Florence de Ponthaud Neyrat à la ville de Chalon... chance ou cadeau empoisonné ?
CONSEIL MUNICIPAL CHALON - Donation de Florence de Ponthaud Neyrat à la ville de Chalon... chance ou cadeau empoisonné ? -
 Au terme d’une longue privation de liberté, Yvan Le Bolloc’h peinera à se remettre à niveau…
Au terme d’une longue privation de liberté, Yvan Le Bolloc’h peinera à se remettre à niveau… -
 Sous une pluie abondante, le championnat de Saône-et-Loire pétanque triplette vétérans est commencé !
Sous une pluie abondante, le championnat de Saône-et-Loire pétanque triplette vétérans est commencé ! -
 VENTE AUX ENCHERES JUDICIAIRES CHALON - Menuiserie, vitrerie, véhicules
VENTE AUX ENCHERES JUDICIAIRES CHALON - Menuiserie, vitrerie, véhicules -
 A Epervans, l'île Chaumette dévoile sa partie hôtel
A Epervans, l'île Chaumette dévoile sa partie hôtel -
 Aston, Staff catégorie 1 : « C’est notre nounours »
Aston, Staff catégorie 1 : « C’est notre nounours » -
 Accident en cours sur la RCEA entre Montchanin et Chalon
Accident en cours sur la RCEA entre Montchanin et Chalon -
 LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - L'eurodéputée Valérie Deloge réaffirme son soutien à Arnaud Sanvert
LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - L'eurodéputée Valérie Deloge réaffirme son soutien à Arnaud Sanvert -
 Absence de ceinture dans les bus... les premières amendes sont tombées
Absence de ceinture dans les bus... les premières amendes sont tombées -
 Une vraie beauté à Saint-Rémy
Une vraie beauté à Saint-Rémy -
 Du nouveau à Epervans : Samuel & Christelle Michelin font évoluer leur entreprise Ki S'éClaT !
Du nouveau à Epervans : Samuel & Christelle Michelin font évoluer leur entreprise Ki S'éClaT ! -
 Vague des conscrits : le retour en images avec Info-Chalon.com
Vague des conscrits : le retour en images avec Info-Chalon.com -
 FOIRE AUX PLANTES DE LA FERTE - Une première journée plébiscitée par les visiteurs
FOIRE AUX PLANTES DE LA FERTE - Une première journée plébiscitée par les visiteurs -
.jpg) TRIBUNAL DE CHALON - Il pousse sa vieille mère au sol, elle attend des heures qu’on la secoure
TRIBUNAL DE CHALON - Il pousse sa vieille mère au sol, elle attend des heures qu’on la secoure -
 HISTORIQUE - L'AS Mellecey-Mercurey sacrée champion de D1 et file tout droit en R3 la saison prochaine
HISTORIQUE - L'AS Mellecey-Mercurey sacrée champion de D1 et file tout droit en R3 la saison prochaine -
 Et si vous vous laissiez embarquer par les fourneaux de François Pelletier et du restaurant Le Saint-Loup ?
Et si vous vous laissiez embarquer par les fourneaux de François Pelletier et du restaurant Le Saint-Loup ? -
 Pour le député Eric Michoux, "je n’ai pas de certificat de légitimité industrielle à demander !" à Sébastien Martin
Pour le député Eric Michoux, "je n’ai pas de certificat de légitimité industrielle à demander !" à Sébastien Martin