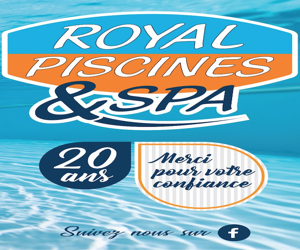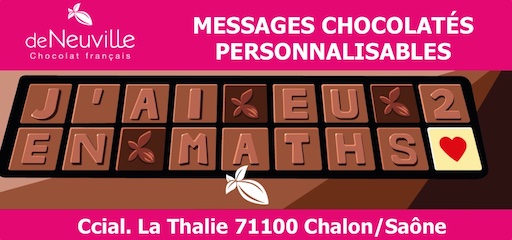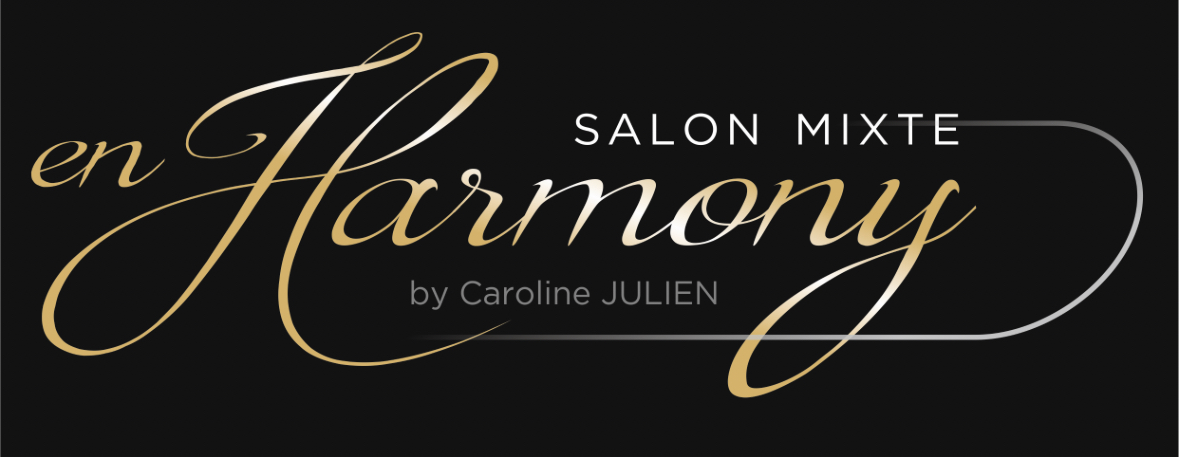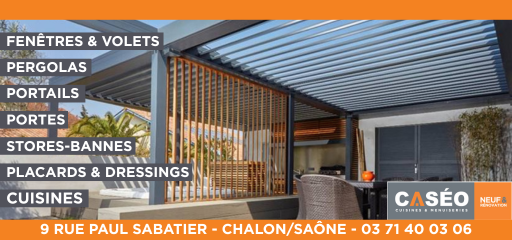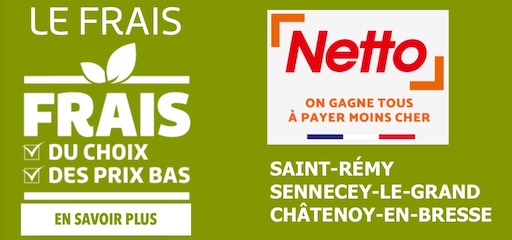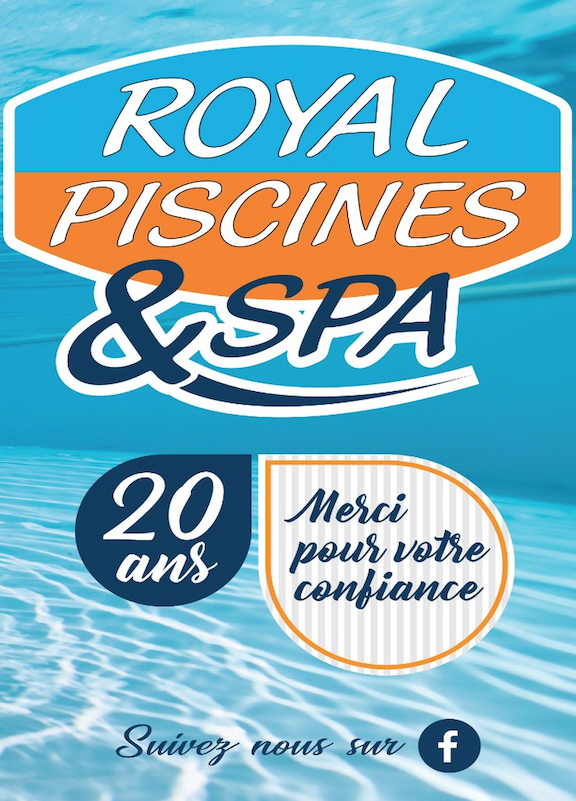Bourgogne
Les femmes en politique ? Des « étoiles filantes »
Publié le 13 Avril 2015 à 13h38

Toujours à l’affût de ce qui pourrait s’avérer susceptible de faire évoluer le regard des lecteurs d’Info-Chalon sur la place des femmes dans notre société, Adèle Pantre s’est rendue vendredi dernier à une conférence de Maud Navarre, organisée par la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de Dijon. Une rencontre riche d’enseignements, sur laquelle Adèle Pantre, notre féministe de service, n’a pas pu s’empêcher de revenir.
Jeune chercheuse en sociologie, par ailleurs journaliste au magazine Sciences Humaines [1], Maud Navarre a consacré plusieurs années de sa vie à la réalisation d’une thèse qu’elle a soutenue en 2013 et qu’elle vient de publier aux Presses Universitaires de Rennes sous le titre suivant : « Devenir élue. Genre et carrière en politique » [2]. La conférence qu’elle a donnée ce vendredi 10 avril à la MSH, visait à livrer sous une forme accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire dans un langage simple, les conclusions de ses remarquables travaux, portant pour l’essentiel sur le personnel politique féminin de la région Bourgogne. Elle a également profité de l’occasion pour revenir sur l’introduction, dans notre droite, de la notion de « parité », avant de dresser un état des lieux de la place des femmes dans les différentes assemblées politiques de notre région. Une conférence pour le moins instructive.
La parité, une notion récemment introduite dans notre droit, mise en musique par de nombreux textes législatifs
Si, pour Maud Navarre, « la parité est la traduction française d’une politique de discrimination positive fondée sur des quotas », le mot sert avant tout à désigner une « répartition égale entre deux groupes », celui des hommes et celui des femmes. En l’occurrence une répartition des responsabilités politiques.
Historiquement, la volonté de répartir également les places politiques entre ces deux groupes commence avec la révision constitutionnelle de 1999, qui modifie les articles 3 et 4 de ce qui constitue le socle de notre ordonnancement juridique : la Constitution du 4 octobre 1958, celle de notre République actuelle, la Vème du nom. En effet, en faisant désormais disposer par ce texte juridique fondamental que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives » (article 3), et que les partis politiques « contribuent à la mise en œuvre » de ce principe énoncé à l’article précité, « dans les conditions déterminées par la loi », cette réforme constitutionnelle introduit la notion de parité dans notre droit. Une notion qui serait restée lettre morte si de nombreux textes législatifs n’avaient été adoptés pour la mettre en musique, lui donner corps. Textes que les partis politiques, largement dirigés par un personnel masculin soucieux de conserver sa position dominante, n’ont eu de cesse de contourner ou de négliger ouvertement, contribuant ainsi à retarder l’arrivée des femmes en politique.
Une montée en puissance qui n’a toutefois pas pu être enrayée. En effet, la féminisation du personnel politique, sous l’impact de lois comme celle de 2013, qui prévoit la confection de liste paritaires pour les communes de plus de 1000 habitants et le scrutin binominal à deux tours pour les élections départementales, est désormais en marche, plus exactement : en cours.
De plus en plus de femmes en politique, mais pas de révolution
Ceci rappelé, si la féminisation du personnel politique des assemblées communales, intercommunales, départementales et régionales est indiscutablement avérée, il n’y a néanmoins pas de quoi pavoiser, le diable se logeant, comme toujours, dans certains détails, pour le moins troublant.
C’est entendu, les femmes en politique sont beaucoup plus nombreuses qu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale, date à laquelle, pour limiter les progrès du Parti communiste dans les urnes, les hommes, partant du principe que les femmes sont en leur for intérieur plus conservatrices, avaient consentis à leur octroyer le droit de vote et d’éligibilité. Néanmoins, elles ne sont pas tant que cela à occuper des postes au niveau des exécutifs territoriaux. En effet, on ne compte que 16 % de femmes maires, que 8 % de femmes présidentes d’intercommunalités et tout juste 2 femmes présidentes de Régions sur 22. Et si l’on ajoute à cela que seulement 10 % sont présidentes de conseils départementaux, une chose est sûre : la féminisation du personnel politique n’a pas entraîné une féminisation des fonctions exécutives au sein des assemblées communales, intercommunales, départementales et régionales, qui restent la chasse (jalousement) gardée des hommes.
Autrement dit, s’il y a de plus en plus de femmes en politique, on est encore loin d’une révolution. Et le jour où les femmes auront le poids qu’ont actuellement les hommes en politique n’est pas encore arrivé.
Les femmes en politique aujourd’hui : des « étoiles filantes », exigeantes avec elles-mêmes, confrontées au sexisme ordinaire
Tout ceci considéré, une chose ne souffre guère de discussion : par rapport aux siècles précédents, ceci n’est toutefois pas discutable, la place des femmes en politique a largement évolué. Les assemblées politiques ne sont plus des clubs exclusivement masculins, desquels les femmes seraient impitoyablement refoulées, exclues.
Partant de cela, et prenant pour étude le personnel politique féminin de la Bourgogne, c'est-à-dire celui de la Région, des quatre assemblées départementales (Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne), les assemblées des communes de plus de 3500 habitants (environ 60), auxquels elle a ajouté les parlementaires bourguignons, Maud Navarre a donc réalisé la thèse de sociologie évoquée plus haut.
Dans cette dernière, elle a plus particulièrement étudié les femmes en termes de « carrière politique », en leur adressant un questionnaire, en réalisant une quarantaine d’entretiens avec des élus et en observant le déroulement de réunions publiques et d’assemblées plénières, notamment les prises parole en public.
Un travail qui permet d’en savoir un peu plus sur les femmes politiques de notre région, tant au niveau de leur parcours, des difficultés qu’elles rencontrent, que des raisons pour lesquelles elles choisissent de s’engager. Car Maud Navarre a tiré des conclusions pour le moins intéressantes de ses recherches et de nombeuses analyses.
La première de ces conclusions est la suivante : les femmes politiques de Bourgogne sont un peu des « étoiles filantes de la vie politique ». A l’instar de ces dernières, elles ont en effet un parcours bref. Il est rare qu’elles se lancent en politique avant l’âge de 45 ans, ou alors entre 20 et 30 ans. Et quand elles le font, c’est pour en sortir aux alentours de 60 ans, à l’âge de la retraite, essentiellement pour s’occuper de leurs petits-enfants…. Pourquoi ne se lancent-elles généralement pas avant 45 ans ? Parce qu’entre 30 et 45 ans, elles ont des enfants et que, malgré certains progrès dans le couple, il leur revient encore de les éduquer, ce qui fera d’ailleurs dire à l’un des participants au débat qui a suivi la conférence – Samuel Bon, ex-directeur de Cabinet du Président du Conseil général de Saône-et-Loire, Rémi Chaintron – que « l’un des principaux obstacles à la montée en puissances des femmes en politique est la place qu’elles acceptent ou plus exactement se résignent à occuper dans le couple, presque toujours favorable à l’ascension sociale des hommes, au détriment des femmes ». Une considération largement approuvée par l’assistance, prompte à remarquer que les hommes pourraient également s’occuper de leurs enfants, ce qu’ils ne font pas, même s’il est vrai que les mentalités évoluent doucement en la matière.
La deuxième conclusion de Maud Navarre est que « le sens de l’engagement politique des femmes n’est pas tout à fait le même que celui des hommes ». En effet, par rapport aux hommes avec lesquels elle a eu le loisir de s’entretenir, les femmes, toutes en proie ou à un « sentiment d’incompétence » que les hommes n’éprouvent pas, paraissent beaucoup plus altruistes dans leur engagement, tant et si bien que celui-ci revêt les apparences d’un « sacrifice au service de la cause publique ». Par ailleurs, elles mettent presque systématiquement en avant la volonté de « bien faire », d’être « exemplaires », d’être « dévouées » à leurs tâches. Autant de préoccupations dont ne font pas état les hommes politiques, plus enclins à avancer d’autres motifs d’engagement, et surtout préoccupés de prendre la lumière, ceci pour leur propre bénéfice.
La dernière grande conclusion de Maud Navarre est aussi que l’on est loin d’en avoir terminé avec le sexisme ordinaire, qui continue de se déployer, de façon plus ou moins subtile, au sein des différentes assemblées politiques de la Bourgogne. Un sexisme que Maud Navarre a pu voir à l’œuvre lors d’assemblées plénières, qu’il s’agisse de remarques perfides des hommes directement liées au sexe de leur interlocutrice ou encore de propos tendant à rappeler aux femmes usant de cette virulence relativement caractéristique des hommes politiques…qu’elles sortent de leur rôle… Un sexisme que Maud Navarre a également pu voir à l’œuvre en observant la répartition du travail politique, qui a pour conséquence d’attribuer aux femmes des portefeuilles ou délégations « en phase » avec l’image que l’on se fait traditionnellement d’une femme : les personnes âgées, le scolaire, etc.
Des conclusions récusées par un professeur de l’Université de Bourgogne
Largement fondées sur des recherches effectuées selon une méthode scientifique reconnue et des analyse reposant sur des données chiffrées fiables, que l’on peut consulter dans l’ouvrage qu’elle vient de publier, les conclusions de Maud Navarre ont suscité un riche débat, durant lequel l’ex-directeur de Cabinet du président du Conseil général de Saône-et-Loire, précité, a pu corroborer, à l’aune de son expérience politique, les propos avancés par Maud Navarre. Elles n’ont toutefois pas convaincu un professeur de science politique de l’Université de Bourgogne, M. Dominique Andolfatto, qui, qualifiant les recherches de la conférencière de « féministes par définition », les a jugées « partiales », « émotionnelles ». En effet, celui-ci a très clairement remis en cause les conclusions de Maud Navarre, sans pour autant convaincre les participants, ne recourant qu’à des exemples dignes du café du commerce, que nous n’évoquerons pas par charité, et faute d’arguments aussi solides que ceux avancés par Maud Navarre.
Le signe que le jour où la femme sera enfin un homme comme les autres n’est pas pour demain ? Ceci, seul l’avenir nous le dira. En attendant, on peut lire utilement l’ouvrage de Maud Navarre qui, lui, a le mérite de discourir à partir de faits avérés, en plus d’être bien écrit.
Adèle PANTRE
[1] http://www.scienceshumaines.com/
[2° Maud NAVARRE, Devenir élue. Genre et carrière politique, Presses universitaires de Rennes, 2015, 257 p, 20 euros



-
 Attention fermeture annoncée du Pont de Bourgogne la semaine prochaine
Attention fermeture annoncée du Pont de Bourgogne la semaine prochaine -
 Accident en cours sur la RCEA entre Montchanin et Chalon
Accident en cours sur la RCEA entre Montchanin et Chalon -
 Inauguration du nouveau supermarché Colruyt de Châtenoy le Royal.
Inauguration du nouveau supermarché Colruyt de Châtenoy le Royal. -
 La saison des orages est ouverte en Saône et Loire
La saison des orages est ouverte en Saône et Loire -
 300 véhicules contrôlés ce lundi par les gendarmes de la compagnie de Chalon sur Saône... et une multitude de contraventions
300 véhicules contrôlés ce lundi par les gendarmes de la compagnie de Chalon sur Saône... et une multitude de contraventions -
 CONSEIL MUNICIPAL CHALON - Donation de Florence de Ponthaud Neyrat à la ville de Chalon... chance ou cadeau empoisonné ?
CONSEIL MUNICIPAL CHALON - Donation de Florence de Ponthaud Neyrat à la ville de Chalon... chance ou cadeau empoisonné ? -
 Au terme d’une longue privation de liberté, Yvan Le Bolloc’h peinera à se remettre à niveau…
Au terme d’une longue privation de liberté, Yvan Le Bolloc’h peinera à se remettre à niveau… -
 Sous une pluie abondante, le championnat de Saône-et-Loire pétanque triplette vétérans est commencé !
Sous une pluie abondante, le championnat de Saône-et-Loire pétanque triplette vétérans est commencé ! -
 A Epervans, l'île Chaumette dévoile sa partie hôtel
A Epervans, l'île Chaumette dévoile sa partie hôtel -
 Aston, Staff catégorie 1 : « C’est notre nounours »
Aston, Staff catégorie 1 : « C’est notre nounours » -
 Accident en cours sur la RCEA entre Montchanin et Chalon
Accident en cours sur la RCEA entre Montchanin et Chalon -
 Elodie, disparue près de Montceau-les-Mines, est rentrée chez elle saine et sauve
Elodie, disparue près de Montceau-les-Mines, est rentrée chez elle saine et sauve -
 LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - L'eurodéputée Valérie Deloge réaffirme son soutien à Arnaud Sanvert
LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - L'eurodéputée Valérie Deloge réaffirme son soutien à Arnaud Sanvert -
 Une vraie beauté à Saint-Rémy
Une vraie beauté à Saint-Rémy -
 Absence de ceinture dans les bus... les premières amendes sont tombées
Absence de ceinture dans les bus... les premières amendes sont tombées -
 Du nouveau à Epervans : Samuel & Christelle Michelin font évoluer leur entreprise Ki S'éClaT !
Du nouveau à Epervans : Samuel & Christelle Michelin font évoluer leur entreprise Ki S'éClaT ! -
 VENTE AUX ENCHERES JUDICIAIRES CHALON - Menuiserie, vitrerie, véhicules
VENTE AUX ENCHERES JUDICIAIRES CHALON - Menuiserie, vitrerie, véhicules -
 Vague des conscrits : le retour en images avec Info-Chalon.com
Vague des conscrits : le retour en images avec Info-Chalon.com -
 Marathon des vins de la côte Chalonnaise : l’heure du bilan ce jeudi avec un chiffre rocambolesque de 156 365 kilomètres parcourus !
Marathon des vins de la côte Chalonnaise : l’heure du bilan ce jeudi avec un chiffre rocambolesque de 156 365 kilomètres parcourus ! -
 FOIRE AUX PLANTES DE LA FERTE - Une première journée plébiscitée par les visiteurs
FOIRE AUX PLANTES DE LA FERTE - Une première journée plébiscitée par les visiteurs -
.jpg) TRIBUNAL DE CHALON - Il pousse sa vieille mère au sol, elle attend des heures qu’on la secoure
TRIBUNAL DE CHALON - Il pousse sa vieille mère au sol, elle attend des heures qu’on la secoure -
 Rassemblement pour la «défense de l'État de droit et de la démocratie» à Chalon-sur-Saône
Rassemblement pour la «défense de l'État de droit et de la démocratie» à Chalon-sur-Saône