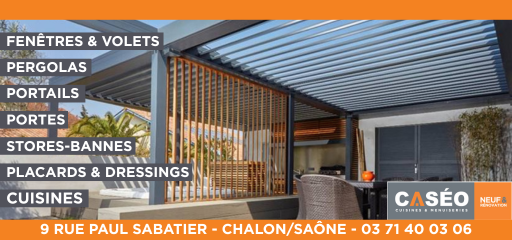Faits divers
ASSISES DE SAONE ET LOIRE - « Y avait maman devant les autres, et maman à la maison. »
Publié le 16 Décembre 2020 à 23h09
D’une phrase, la fille aînée de Catherine de Conto résume les heures d’intervention des experts psychiatre et psychologue qui ont exposé leurs rapports, ce mercredi 16 décembre, devant la Cour d’assises de Saône-et-Loire. L’accusée a avoué avoir tué son fils âgé de 8 ans, avoir commis ce crime impensable. Qu’est-ce qui peut expliquer son passage à l’acte ?
L’accusée n’est ni malade, ni folle, ne fut pas la proie d’une bouffée délirante
« C’est construit comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais c’est construit comme ça », dit la présidente Podevin à la fille aînée qui se tient à la barre en fin de journée. Comme ça ? Reprenons les propos des experts, à qui la présidente doit apprendre que l’accusée a avoué.
Le docteur Prieur, médecin psychiatre, et madame Laurent, psychologue clinicienne, ont en effet rencontré l’accusée alors incarcérée à la maison d’arrêt de Dijon, en juin et juillet 2018, alors qu’elle s’accroche à un récit inventé. « Pas de dangerosité criminologique, pas de risque de réitération, pas d’altération ni d’abolition du discernement », a conclu l’expert psychiatre. L’accusée n’est ni malade, ni folle, ne fut pas la proie d’une bouffée délirante. Le médecin est formel sur ce point, car une bouffée délirante, « ça laisse des traces », « elle n’aurait eu aucun souvenir, et donc n’aurait pas mis des stratagèmes en place pour détourner les soupçons ». La bouffée délirante relève « d’un accident psychotique aigu », ce n’est pas ce qui s’est passé dans le cas de Catherine de Conto.
Un éclairage qui ajoute au tragique
L’éclairage que donnent tour à tour médecin et psychologue est à la fois plus simple et plus tragique sans doute, puisque finalement on ne peut se raccrocher à rien, on ne peut que faire le constat du drame. La justice le sanctionnera, car notre société ne permet pas que l’on tue quiconque, mais cette tragédie était-elle évitable ?
Maltraitante, au fond, bien que « pas repérée comme telle »
Cette maman « n’est pas repérée comme maltraitante », répète la présidente, Caroline Podevin. Et d’une certaine façon, elle ne l’est pas. Pourtant elle l’est, sans forcément le savoir, et les enfants (sa fille en témoignera avec ses mots) en souffrent mais de quoi pourraient-ils se plaindre puisque finalement tout ne se manifeste que confusément. Femme « rigide » chez qui viennent en première ligne « les questions d’emploi du temps et d’organisation de la journée. La dimension du plaisir, on ne la trouve pas, sauf au moment du coucher ». Ce fameux moment, décrit par la mère comme un doux rituel, illustre les formes d’abus fusionnels. Chaque soir, un massage, des bisous. Oui mais, l’enfant a 8 ans, il est trop grand pour ce genre de tripotages, et qu’ils soient chastes n’y change rien car ils sont déplacés.
Une personne « obsessionnelle », qui rumine beaucoup
A ce sujet, la question des places, mal définies, confuses, revient comme souvent dans les affaires judiciaires (mais à l’image de ce qui se passe hélas fréquemment un peu partout) : « on était plus copines que mère et fille », Luca prenait chaque soir une tisane, comme sa maman, mais parfois avec des tic-tac qui figuraient les cachets qu’elle prenait. Le médecin comme la psychologue sont frappés par « le discours très froid, sans aucune manifestation émotionnelle » de la mère. Et ça nous amène sur un autre aspect de sa personnalité que les tests psychologiques illustrent bien : à l’avant-plan, une personnalité visible par tous, adaptée autant que possible et conforme autant que possible, c’est quelqu’un d’actif, qui a besoin de réussir. A l’arrière-plan, un sentiment d’insuffisance, « une colère intense et de l’anxiété, complètement dissimulées ». C’est une personne « obsessionnelle », qui rumine beaucoup.
Sous la carapace sociale, des ressources internes inopérantes
Et sa fragilité (le mot paraît faible, car c’est aussi ce qui la rendait très dangereuse, et le petit en a fait les frais) est là, dans ce « ça s’est construit comme ça » : ses ressources internes sont insuffisantes, « pas opérantes » et sous l’effet de trop d’émotions, elle pouvait se voir envahie (il faut comprendre que cet envahissement est très violent pour la personne) d’émotions et de fantasmes « désorganisateurs ». Pour se protéger de cet effondrement qui menaçait, la personne s’est clivée : d’un côté ça tenait, sur un mode qui devait pour une part singer les bonnes pratiques (ce sont nos mots), mais sans investissement sincère, car sans empathie, par exemple (personne égocentrée, pas capable d’être autrement, « comme si elle était seule au monde »), qui se forge « une carapace sociale » dit la psychologue ; de l’autre côté « un appauvrissement pathologique de la relation d’objet », la personne est tournée vers sa propre jouissance, sans nécessairement en être consciente. En résumé, « quelqu’un qui est adapté au réel objectif mais cet ajustement se dégrade dès que les affects interviennent », et ça, c’est dangereux, c’est la menace de désorganisation interne, et ça rend ces personnes très interprétatives, très agressives, elles sont alors dans le rejet, voire…
Avoir le contrôle : une obsession pour se protéger d’un effondrement
Pourtant le psychiatre l’avait menée au bord du gouffre, « elle s’était approchée le plus près possible qu’elle le pouvait alors » d’une vérité alors enfouie en elle, « enfermée », lorsqu’il lui a demandé, quand elle a dit revoir « la main de l’agresseur », de la décrire. Elle a alors soulevé la sienne. Puis elle a dit « elle était gantée ». Le psychiatre glisse : est-ce ça pourrait être votre main ? Elle s’est effondrée. Puis elle s’est reprise. A la psychologue elle a beaucoup répété « les dernières paroles de Luca » (qui n’ont pas réellement existé mais qui étaient devenues vraies pour la mère), « maman j’étouffe, aide-moi », et répétait également « je n’ai pas pu faire ça, ce n’est pas moi qui ai fait ça ». « Elle contrôlait tout, dit la psychologue, et là, non. Le clivage (barrière étanche entre son vécu émotionnel qui est destructeur pour elle et le récit qui rend la situation supportable) la protège d’un effondrement. »
« L’enfant est là pour la compléter »
Aux deux experts, Catherine de Conto a décrit son enfance comme plutôt normale. Pourtant elle fera des dépressions après chaque rupture, séparation ou deuil, au cours de sa vie. Son premier conjoint la quitte après la naissance de leur fille, laquelle fille demandera à vivre avec lui alors qu’elle est collégienne, cela lui sera accordé, sa mère le vit comme une trahison et un abandon. Le père de Luca ne voulait pas de cette grossesse tardive (elle avait 41 ans), elle a gardé l’enfant espérant secrètement qu’il reviendrait, il n’est pas revenu. Le psychiatre relève, et cela va avec le reste, « la position particulière qu’elle assigne à l’enfant, qui est là pour la compléter ». C’est toujours la rupture qui génère un sentiment d’abandon. Il est possible, dans ce contexte, qu’elle ait tué son fils pour qu’il reste à jamais l’enfant parfait et ne devienne jamais celui qui, une fois encore, s’éloignera d’elle. C’est une hypothèse que formule le psychiatre, qui est formel sur un autre point : elle a pu oublier la scène réelle, « c’est très classique en criminologie », mais par contre elle sait qu’elle est l’auteur du crime.
« Fonctionnement limite »
Mélange des places de chacun, confusion, fusion, culture de l’image sociale pour masquer un vide (que les enfants ressentent forcément, eux) … Madame Laurent nous offre un peu de culture. Le plus désorganisé, c’est la psychose. Ensuite, il y a les fonctionnements limites, qui ont des problématiques de nature identitaire, avec des angoisses d’abandon. Ces personnes ont des difficultés à distinguer soi et l’autre, et leur capacité relationnelle n’est que de surface. Les réponses sont dominées par la forme, le contrôle émotionnel est extrêmement difficile. Enfin, les plus chanceux d’entre nous ont des névroses, qui lorsqu’elles sont stables ne font pas obstacle à vivre sa vie.
Elle pourrait dire : « j’aime mon enfant et je l’ai tué »
Voilà, on ne sait pas pourquoi mais l’accusée est construite « comme ça », et ce « comme ça » est fait de tellement d’ambivalences qu’elle pourrait dire : « j’aime mon enfant et je l’ai tué », parce que la question de l’amour n’est jamais tout. Sa fille, dans un courrier qu’elle lui avait adressé à la maison d’arrêt, avait casé dans le même élan : « suicide-toi », et « je t’aime ». La jeune femme a témoigné calmement. Elle, elle avait investi son petit frère avec beaucoup d’amour, il était « trop », dit-elle. « Trop gentil, trop beau, trop tout. » Elle dit aussi qu’elle ne parvient pas à ne pas être en contact avec sa mère. Pourquoi ? « Parce que c’est ma mère. » La présidente lui sourit : bien sûr, c’est sa mère. La magistrate insiste sur « cet aspect double » : « votre mère voulait donner le change, mais il y a des choses qu’elle n’arrivait pas à maîtriser, c’est construit comme ça, elle ne fait pas toujours exprès ».
La justice va condamner, mais engage la fille aînée à faire ce qu’il faut pour elle et pour sa propre fille
L’audience s’achève sur cette intersection : la justice, donc la société, juge, et va condamner l’accusée pour son acte terrible, elle le doit à Luca également. Mais la jeune femme, déjà mère elle-même, a sa vie à bâtir, il va falloir « mettre à sa place tout ce qui ne l’était pas » comme le lui dit avec bienveillance la présidente. Quant à porter des vêtements à sa mère en prison pour son anniversaire : oui, évidemment, car tout le monde a le droit à l’amour. Sans exception.
Par contre, la fille soutient que son frère lui avait dit que sa maman avait déjà tenté le coup de la couette, qu’elle avait dit que c’était un jeu mais que le petit a eu peur, tout de même, parce qu’il ne respirait que difficilement. Si c’était le cas (impossible de le prouver, mais les jurés ont à se forger une intime conviction), cela serait porté à charge contre la mère, car une chose est d’avoir des problèmes personnels, une autre est de le faire payer à autrui, jusqu’à lui ôter la vie.
Florence Saint-Arroman



-
 Changement de nom pour la franchise « Stéphane Plaza immobilier » : l’équipe de l’agence Chalonnaise a fait son choix !
Changement de nom pour la franchise « Stéphane Plaza immobilier » : l’équipe de l’agence Chalonnaise a fait son choix ! -
 300 véhicules contrôlés ce lundi par les gendarmes de la compagnie de Chalon sur Saône... et une multitude de contraventions
300 véhicules contrôlés ce lundi par les gendarmes de la compagnie de Chalon sur Saône... et une multitude de contraventions -
 Attention fermeture annoncée du Pont de Bourgogne la semaine prochaine
Attention fermeture annoncée du Pont de Bourgogne la semaine prochaine -
 VENTE AUX ENCHERES JUDICIAIRES CHALON - Menuiserie, vitrerie, véhicules
VENTE AUX ENCHERES JUDICIAIRES CHALON - Menuiserie, vitrerie, véhicules -
 Sous une pluie abondante, le championnat de Saône-et-Loire pétanque triplette vétérans est commencé !
Sous une pluie abondante, le championnat de Saône-et-Loire pétanque triplette vétérans est commencé ! -
 Un appartement en location aux couleurs d'Harry Potter à Chalon
Un appartement en location aux couleurs d'Harry Potter à Chalon -
 Aston, Staff catégorie 1 : « C’est notre nounours »
Aston, Staff catégorie 1 : « C’est notre nounours » -
 Du nouveau à Epervans : Samuel & Christelle Michelin font évoluer leur entreprise Ki S'éClaT !
Du nouveau à Epervans : Samuel & Christelle Michelin font évoluer leur entreprise Ki S'éClaT ! -
 LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - L'eurodéputée Valérie Deloge réaffirme son soutien à Arnaud Sanvert
LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - L'eurodéputée Valérie Deloge réaffirme son soutien à Arnaud Sanvert -
 LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Accary, Platret et Martin réunis pour une annonce officielle
LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Accary, Platret et Martin réunis pour une annonce officielle -
 FOIRE AUX PLANTES DE LA FERTE - Une première journée plébiscitée par les visiteurs
FOIRE AUX PLANTES DE LA FERTE - Une première journée plébiscitée par les visiteurs -
 Législative partielle dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire : Sébastien Martin annonce sa candidature
Législative partielle dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire : Sébastien Martin annonce sa candidature -
 Coup de gueule : ras-le-bol de ces champions de l’incivisme !
Coup de gueule : ras-le-bol de ces champions de l’incivisme ! -
 La triplette vétérans de pétanque de Crissey Alain Buchaillot, Eric Rossignol et Marc Bouhot championne de Saône-et-Loire, qualifiée pour les championnats de France!
La triplette vétérans de pétanque de Crissey Alain Buchaillot, Eric Rossignol et Marc Bouhot championne de Saône-et-Loire, qualifiée pour les championnats de France! -
 Les 50 jours du Bac avec info-chalon.com
Les 50 jours du Bac avec info-chalon.com -
 Rully : bientôt une crèche au cœur du village
Rully : bientôt une crèche au cœur du village -
 A la découverte de l'histoire de la Place de l'hôtel de ville de Chalon - la Société d'Histoire et d'archéologie propose sa prochaine conférence
A la découverte de l'histoire de la Place de l'hôtel de ville de Chalon - la Société d'Histoire et d'archéologie propose sa prochaine conférence -
 LÉGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Sébastien Martin plonge dans le grand bain
LÉGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Sébastien Martin plonge dans le grand bain -
 Grave accident sur l’A6 : un poids lourd traverse les voies, un blessé grave
Grave accident sur l’A6 : un poids lourd traverse les voies, un blessé grave -
 Conscrits Epervans : le retour en images avec Info Chalon
Conscrits Epervans : le retour en images avec Info Chalon -
.jpg) TRIBUNAL DE CHALON - « Une vie familiale désastreuse dont le chien fut le principal martyr »
TRIBUNAL DE CHALON - « Une vie familiale désastreuse dont le chien fut le principal martyr » -
 L’Atelier Bijou Créatif’ a fêté ses 35 ans d’activité à Chalon-sur-Saône
L’Atelier Bijou Créatif’ a fêté ses 35 ans d’activité à Chalon-sur-Saône